Discussion à propos de thèmes relatifs à la philosophie et la spiritualité
Nécessité de déconstruction de l’imprégnation empirique
Étiqueté : empirisme, expérience, traumatisme
- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
 Admin du site, le il y a 3 années.
Admin du site, le il y a 3 années.
-
AuteurMessages
-
-
21 novembre 2021 à 21 h 53 min #1754
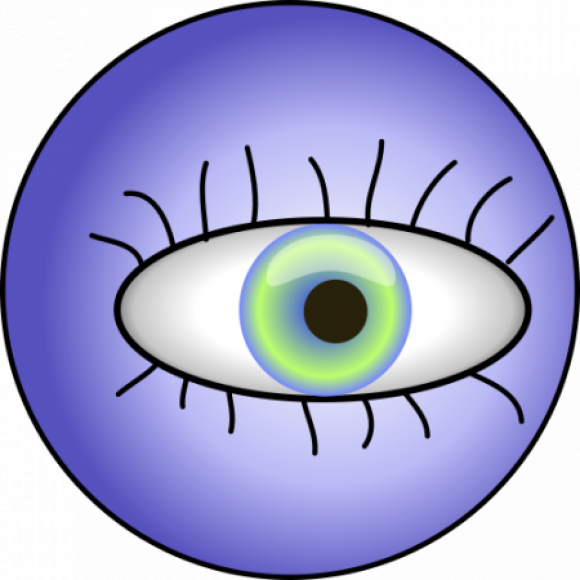 Admin du siteMaître des clés
Admin du siteMaître des clésQu’est ce que la nécessité de déconstruction de l’imprégnation empirique, et pourquoi ?
Il s’agit tout d’abord de prendre en considération les individus fortement marqué par les expériences en tout genre, pour quelques raisons, parmi lesquelles :
- excellente mémoire de façon générale
- facilité à intégrer et revivre mentalement une situation, parfois de façon très détaillée
- nécessité psychologique à résoudre toutes sortes de problèmes
- volonté de justice et d’équité entre humains
Ces caractéristiques entrainant alors un fort marquage du vécu, au point de reconnaître les prémisses et pressentir ce qui pourrait alors advenir, avec parfois des difficulté à imaginer autre chose, ou sinon quand même à être fortement impacté par cette mémoire empirique.
Pour donner quelque exemple, d’ordre divers :
- il vous est arrivé d’avoir un petit accrochage (ou accident de voiture) dans une portion de route. Par la suite, à chaque fois que vous passerez sur la même route, ou en son approche, vous repenserez à l’accident et aurez alors une réminiscence de celui ci. En fonction de la gravité de l’accident, cela pourra aller d’une simple petite appréhension invitant à prudence à une angoisse bouleversante vous donnant envie de prendre un autre chemin
- Dans vos relation sociale, vous avez tenté d’établir un contact avec une personne qui sembla alors fort sympathique. En introduction, vous vous présentez tant bien que mal, et alors la personne se met dans un état furibond (pour “x” raison) et vous assène d’insultes et propos tout autant déplacés que dégradants. Par la suite, en allant tenter de faire connaissance avec d’autres personnes, vous serez dans une angoisse propre au souvenir de cette mauvaise expérience, relativement à l’intention première (faire connaissance), à chaque fois que ce présentera cette occasion; peut être même au point de vous pousser à la solitude de peur de revivre cela.
- D’ordre alimentaire cette fois. On vous apporte un plat cuisiné que vous ne connaissiez pas encore. Vous le regardez, le sentez, et il se trouve que l’odeur et l’aspect vous en rappelle un autre que vous adorez. Mais là, stupeur, surprise et déception : ce plat à un goût tout autre qui vous inspire, dès la première bouchée, un dégoût au point de recracher immédiatement le plat qui vous paraît alors abject. Il en découle potentiellement deux choses :
- erreur d’appréciation basé sur l’expérience précédente : ce plat eut été sans doute meilleurs si vous n’aviez pas tenté initialement de le comparer au plat connu
- conséquence sur le plat connu : plat que vous connaissiez aura, en raison du dégoût sur cette innovation, un tout autre aspect la prochaine fois qu’on vous le préparera; nouvellement, il aura également un dégoût prononcé à l’idée d’en remanger à cause de cette mauvaise expérience qui aura semé le doute dans votre mémoire gustative
Passé ces trois petits exemples qui auront, je l’espère, présenté une clarté aussi bien que l’étendu du potentiel de notre problématique, je tiens à préciser une fois de plus que, dans notre étude présente, nous intéresse en priorité les individus ayant donc ce fort impact empirique, au point d’avoir difficultés à s’en défaire.
A titre de comparaison, vivre une expérience ressemble alors plus à une gravure dans du marbre, qu’à un écrit au crayon papier sur une feuille.
De façon générale, nous avons tous un vécu propre qui induit, en conséquence, un marquage plus ou moins profond selon la façon dont on l’aura vécu. Mais une fois de plus, je prends cette généralité pour mettre en exergue les sujets pour lesquels tout ou presque tout tiens un marquage empirique profond.
Passé cette introduction, se pose alors la question : comment faire ?
Ou plus exactement : comment outrepasser cette imprégnation empirique pour moduler les expériences futur afin qu’elles ne soient pas trop perturbées aussi bien par de bonnes que mauvaises expériences.
Aussi bien les bonnes que les mauvaises, car c’est surtout l’aspect “trompeur”, où l’on croit alors reconnaître ce qu’on croit connaître, mais qui n’est en définitive pas forcément l’identique, voir possiblement ne présentera quasiment aucun point commun autre que celui qui nous aura apparu.
C’est cet aspect là qu’il convient d’intégrer : relever la soupape de la certitude pour laisser s’infiltrer la notion de multipotentialité des objets et situations diverses. Dissoudre les généralités et préjugés pour cultiver la diversité et multiculturalité, en laissant la porte ouverte aux champs des possibles.
Bien sûr, cet exercice demande de la réflexion sur soi et sur le monde autour de soi. Savoir reconnaître lorsque des stigmates induisent en erreur, tout autant que reconnaître ce qui s’avère néanmoins toujours vrai.
En quelques mots : pratiquer la souplesse empirique pour contrecarrer les potentiels effets secondaires de l’imprégnation empirique.
-
10 mai 2022 à 11 h 01 min #1776
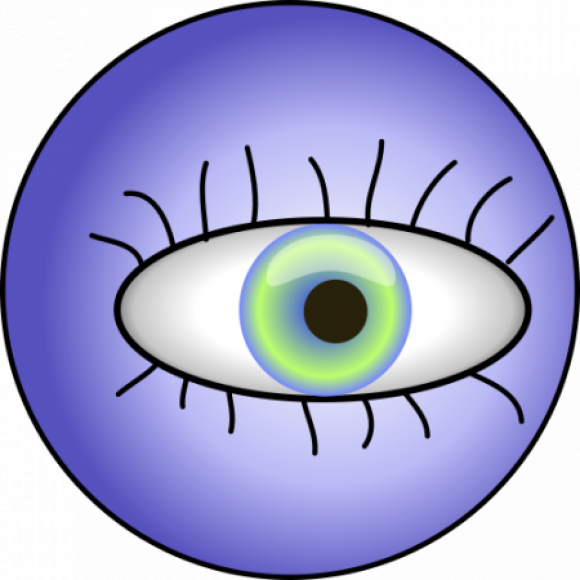 Admin du siteMaître des clés
Admin du siteMaître des clésParallèlement à cette problématique, si tant ardu à comprendre dans son ensemble relativement au causes et conséquences, que simple dans sa structure de façon générale, il réside un curieux phénomène que je qualifierais de “point de bascule”, entre la capacité cérébrale induisant d’une part le marquage empirique à court terme et d’autre part celui à long terme.
Dans les paramètres à prendre en compte, il en est un des plus paradoxal : les conséquences, pouvant induire désarrois voir dévastation dans le for intérieur de l’individu subissant, semble intimement lié aux capacités cognitives.
En effet, une personne plutôt “lente” et “limitée”, qui n’aura pas capacité à emmagasiner des systèmes complexes, sera plus encline à passer outre certaines expériences négatives. Tandis qu’une personne d’intelligence moyenne captera dans ses registres une façon bien précise, sans plus se poser de question, et se limitera à cela avec les conséquence parfois dramatique qui en résulte. Au delà, une personne ayant des capacité cognitive supérieure, sera capable de faire le tri, d’évaluer ou réévaluer, et finalement s’adaptera avec plus ou moins de souplesse, tout en arrivant à bien le vivre. Enfin, au delà d’un certain seuil d’intelligence, là très spécifiquement mais pas exclusivement lié aux personnes ayant une extraordinaire mémoire générale ou sélective, et de surcroît une intelligence leur rendant aisément accessible des système ultra complexe (là où certain qualifierais d’abscons, ce sera “simple” pour eux), vivront les expériences traumatisante avec un impact bien plus important que toutes autres personnes, au point parfois d’en être dévastés pendant des années.
Là joue donc le “facteur temps”. Certes l’intelligence permet de relativiser et intellectualiser, mais au fond de soi, même si on a bien compris, il faudra d’autant plus de temps à réparer qu’on aura alors une intelligence hors normes.
On peut coupler ces principes avec la question de la “patience”, qui corrobore avec l’appréhension du facteur temps et les limites insolubles autrement que par la pratique du “chaque chose en son temps”.
Cependant, il convient d’impérativement distinguer ce que l’intellect aura formé comme données statistiques et informatives intelligibles, de celle du ressenti, sentiment et ressentiment profond de l’être.
C’est sur ce dernier point que résidera la difficulté insurmontable, pour une personne doté d’une intelligence supérieure, avec l’influence que cela peut avoir sur tout le reste de la vie.
Ceci exigeant alors un travail supplémentaire, que la plupart n’auront donc pas besoin de faire, afin de retrouver et cultiver (apprendre à cultiver) un certain équilibre psychique et intellectuel, voir de confort de vie de façon générale.
-
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.